Devenir lecteur-correcteur, épisode 3 : être correcteur freelance, un statut idéal pour les touche-à-tout
Si le statut de salarié offre une sécurité, celui de freelance permet de conjuguer plusieurs « métiers ». C’est ce que Estela Bonnaffoux a décidé de faire pour conjuguer toutes ses passions. Un statut qui lui permet d’exercer le métier de correcteur en toute liberté !
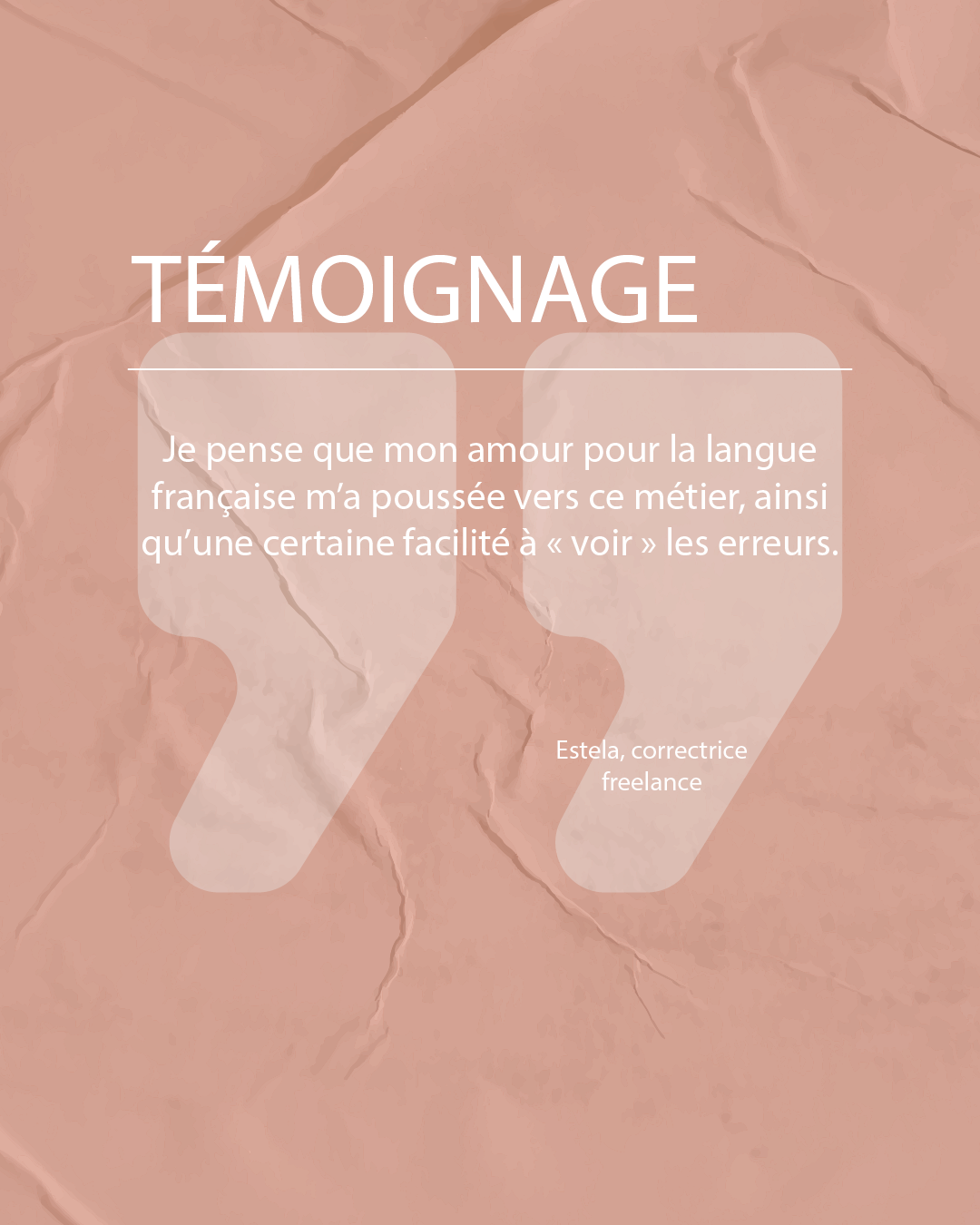
1. Présentez-vous.
J’ai 39 ans, je vis à côté de Tours depuis une dizaine d’années et j’ai des attaches en Auvergne. Je partage mon quotidien avec un compagnon médecin et deux (grands) beaux-enfants.
2. Comment êtes-vous devenue correctrice ?
J’ai suivi un cursus littéraire : un bac L, deux ans de classe préparatoire, une licence et un master 1 de Lettres classiques. Après un passage dans l’enseignement, j’ai repris des études. J’avais dans l’idée de me lancer dans les humanités numériques, notamment dans l’édition et la valorisation de textes anciens. Au lieu de cela, j’ai fait un master de recherche, puis j’ai enchaîné avec un doctorat en Histoire des sciences au Centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR).
Au cours de ma thèse, j’ai eu un contrat d’ingénieure d’études au sein d’un projet de recherche. L’un des volets de ce travail était la relecture et correction : du site Internet du projet, des articles publiés en ligne, des actes du colloque, de rapports administratifs, etc. Je travaillais en open space et j’étais en contact avec plusieurs collègues dont le français n’était pas la langue maternelle. Il m’est fréquemment arrivé de relire leurs candidatures ou leurs articles pour leur donner un coup de main. Je me suis rendu compte qu’aider les autres à perfectionner leurs écrits me plaisait, et j’ai décidé de me lancer dans cette aventure ! J’ai commencé chez Scribbr, une plateforme dédiée à la correction d’écrits universitaires. J’ai été formée en interne, et j’ai découvert que la relecture-correction était plus complexe qu’il n’y paraît !
3. C’est donc un peu par hasard que vous avez commencé à corriger des textes pour d’autres personnes. Qu’est ce qui vous a attirée dans ce métier de lectrice-correctrice et qui vous a amenée à continuer dans cette voie ?
J’ai toujours aimé lire… et j’ai toujours aimé corriger les erreurs qui pouvaient rester dans les livres. Ma bibliothèque porte les marques de cette passion un peu atypique. Romans, B.D., essais… dans tous mes livres, on peut trouver un « s » ajouté, un accord corrigé, une virgule supprimée. Je pense que mon amour pour la langue française m’a poussée vers ce métier, ainsi qu’une certaine facilité à « voir » les erreurs. Mais il ne faut pas croire qu’être bon en orthographe suffit : il faut aussi maîtriser la typographie et sans cesse vérifier les règles et les usages. Enfin, on est amené à lire des textes issus de domaines très variés. C’est l’un des aspects qui me plaît le plus, dans ce métier : on apprend et on découvre toujours de nouvelles choses !
4. Comment exercez-vous ce métier de correctrice ? À plein temps ? Avez-vous une activité complémentaire ?
Je suis autoentrepreneure et c’est mon emploi principal. J’ai toutefois d’autres activités qui ne relèvent pas de la relecture-correction. J’ai gardé un pied à l’Université : toujours sous le statut d’autoentrepreneure, j’exerce des activités d’appui à la recherche (principalement de la rédaction de contenus de vulgarisation ou de la transcription de manuscrits anciens). Je suis également chargée de cours à l’université de Tours : j’enseigne le latin de la Renaissance.
5. Vous avez donc l’habitude de travailler en toute autonomie, et ce, depuis vos études. Quelles sont, selon vous, les qualités qu’il faut avoir ou développer pour devenir correcteur indépendant ?
Il faut savoir s’organiser : travailler à son compte est un avantage et offre une liberté certaine, à condition d’être capable de gérer son emploi du temps. Il y a des dates butoirs à respecter et certaines périodes sont plus chargées que d’autres : on doit parfois jongler avec les missions. Face à son commanditaire, il faut rester humble : nous devons l’accompagner sans nous approprier ses mots. Un bon correcteur fait preuve de rigueur, a le sens du détail, mais doit par ailleurs — même si cela peut paraître contradictoire — se montrer flexible. Parce qu’il faut respecter le texte, son auteur, et que, contrairement à ce que l’on peut penser, en matière de langue, rien n’est jamais gravé dans le marbre. Et peut-être que les correcteurs sont tous un peu des nerds de la langue, aussi : il faut aimer se poser des questions existentielles sur les virgules ou passer des heures à chercher la réponse à une question syntaxique complexe.
6. Quels sont vos domaine de prédilection, vos sujets favoris ?
Les travaux universitaires sous toutes leurs formes (thèses, mémoires, articles, essais…). Mais j’évite les disciplines et les périodes qui me sont familières, car je trouve difficile de s’attacher uniquement à la forme lorsqu’on connaît bien le fond.
7. Cela peut être confortable de connaître un sujet pour corriger un texte… mais pas trop ! Qui sont vos commanditaires d’ailleurs ?
Ce sont principalement des particuliers : des universitaires (professeurs, étudiants d’origine étrangère, doctorants) ainsi que quelques auteurs en autoédition. Depuis quelques années, j’ai diversifié mon activité de correctrice. Je suis devenue formatrice au sein de l’EFLC, j’ai travaillé avec une maison d’édition, et, plus récemment, avec une agence de communication.
8. Y a-t-il un monde entre l’idée que vous aviez du métier de correcteur et la réalité ?
Je n’avais pas une idée bien précise de ce métier, mais j’étais loin d’imaginer qu’il pouvait être si complexe et si stimulant ! Il y a parfois un petit côté « enquête » que je ne soupçonnais pas, quand il faut croiser différentes sources (dictionnaires, grammaires, etc.) afin de trouver LA bonne correction. Et en dépit des apparences, c’est un métier ancré dans le vivant. Comme l’a fait remarquer Julie, la langue n’est pas figée ; elle change selon le contexte, les personnes qui la manient, le territoire où elle se développe… On n’écrit pas non plus de la même façon qu’il y a 50 ans : le métier de correcteur tient compte de cet aspect vivant du français.
9. Quel conseil donneriez-vous à ceux ou celles qui veulent devenir correcteur ?
De se former. On ne peut s’improviser correcteur : comme tout métier, cela s’apprend ! Il faut en outre être patient et se laisser du temps pour pouvoir vivre de cette activité. C’est au fur et à mesure que vous pourrez vous constituer un réseau et trouver des clients réguliers. Échanger avec des personnes déjà en exercice peut-être une bonne idée, par exemple via les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou LinkedIn.
10.Que souhaitez-vous ajouter à l’adresse de toutes les personnes qui aimeraient se lancer en tant que correcteur indépendant ?
Si le métier vous tente, foncez ! Le fait que, aujourd’hui, il s’exerce principalement en freelance et en télétravail ne doit pas être un frein. Personnellement, j’y ai trouvé un équilibre. Je travaille de chez moi, à mon rythme. C’est un métier solitaire mais aussi solidaire : même à distance, les collègues ne sont jamais bien loin pour nous aider lorsqu’on hésite sur une correction, ou pour accompagner nos pauses café.
Merci, Estela, d’avoir répondu à nos questions. Cela prouve qu’exercer le métier de correcteur à son compte a de nombreux avantages. Mais il faut être conscient que cela ne convient peut-être pas à tout le monde et qu’avoir plusieurs activités est un avantage, voire une condition sine qua non pour se lancer dans le métier sereinement.
Retrouvez les autres interviews de correcteurs sur notre blog ! N’hésitez pas à nous contacter à contact@eflc.fr si vous êtes correcteur et que vous souhaitez témoigner.
